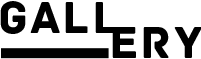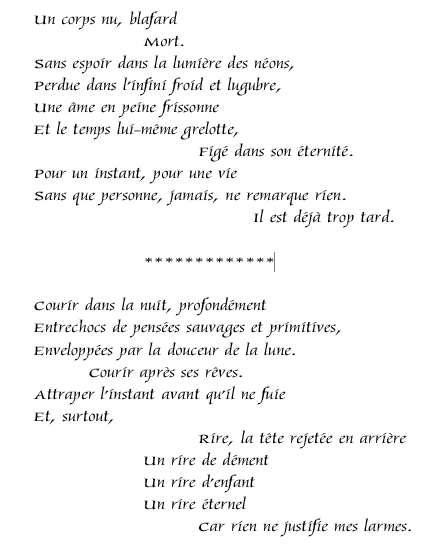Quelques textes, en vrac… EN CONSTRUCTION
Imparfaits, parfois datés, ces textes sont des instantanés de vie ou de rêve.
Tous sont © Julie Turconi (Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur)
- Le facteur – extraits de mon roman Le facteur, initialement publié aux éditions Robert Laffont Canada, avant qu’elles ne deviennent Éditis Canada et que le roman ne soit mis en arrêt de commercialisation.
- Fractales – extrait de mes fragments poétiques (dont certains se retrouvent dans mon exposition Fractales, haïkus visuels), écrits au fil du temps depuis la pandémie (2020 – …)
- Catharsis – poésie (lu lors du tournage du film Triptyque de Robert Lepage et Pedro Pires en avril 2010 et publié dans Chemins de Traverse, France, 2008)
- Emergence – poésie (dans la langue de Shakespeare)
- Boucle – récit de rêve
- Ab irato – nouvelle
- Sur un banc – nouvelle (un des premiers textes que j’ai écrit à Montréal)
- Ombrage – nouvelle (publiée dans Brèves Littéraires # 74 – automne 2006)
Extrait 1
Cette première fin de semaine, François n’a même pas le courage de sortir de la ville pour aller marcher dans les bois et se ressourcer au contact de la nature, loin de la foule et du bruit. Il n’en a pas la force. Sa semaine pèse dans son corps, tire dans ses jambes et il se sent las. Pourtant, il se réveille à la même heure que les matins précédents. Il semblerait que son organisme ait pris le pli. François se donne quelques minutes supplémentaires dans la pénombre. Il essaie de se rendormir, sachant qu’il aurait besoin de récupérer, mais rien à faire. Il en est incapable. La fatigue l’écrase et pulse au fond de ses yeux grands ouverts. Ses paupières refusent de rester baissées. Il pourrait presque entendre son cerveau ronronner et cliqueter comme un vieux mécanisme qui se met en route. Alors, plutôt que de tourner et virer inutilement entre ses draps, François se lève. Il s’étire longuement, assis au bord de son lit, les pieds sur le sol frais. Puis il va mettre de l’eau à chauffer pour son thé du matin. Il passe à la salle de bain, où il ne peut éviter de croiser son propre regard dans le miroir. Il contemple longuement son visage. Celui d’un homme épuisé par de trop longues luttes, aux traits marqués et anguleux. Ses cheveux courts, presque ras, sont encore ceux d’un soldat. Ses yeux noisette, autrefois vides et ternes, brillent aujourd’hui d’un éclat nouveau. Il a toujours de profonds cernes bleutés, mais il se sent intérieurement mieux qu’il ne l’a été depuis des mois. L’exercice physique lui fait du bien. La solitude l’apaise.
Ses pensées se perdent dans le vide. Des images défilent devant ses yeux, dessinant leurs contours sur la buée du miroir. Aujourd’hui, ces images n’ont rien d’effrayant. Ce sont des clichés pris sur le vif, parfois un peu flous, comme les vieilles photos jaunies du temps passé. Ce sont des instantanés de vie dont il fait un peu partie, malgré lui. Tous les jours, il marche le long de rues aux noms parfois improbables. Il monte des escaliers tantôt vieillissants et qui auraient besoin d’un peu d’attention, tantôt flambants neufs. Il tombe parfois sur de belles portes anciennes, en bois, joliment décorées, vestiges d’une autre époque, ou sur des entrées colorées, peintes pour défier la grisaille de la ville ou, peut-être, la blancheur de l’hiver. Il découvre tout un monde qui lui était jusqu’alors inconnu. Un monde de matières : le béton et l’asphalte des rues, les pierres ou les briques des façades de maisons ou d’immeubles, le bois des portes et clôtures, le verre des vitres et ses reflets du monde, le métal et l’acier de certaines structures commerciales, l’eau des fontaines ornementales… Et pourtant, c’est aussi un monde profondément humain qui se révèle petit à petit à lui : chaque cour, chaque foyer a une histoire, qu’il essaie d’imaginer au fil des jours. Même les objets les plus ordinaires sont des témoins privilégiés de la vie qui déroule inlassablement son fil partout autour de lui : une balançoire qui rouille et grince dans le vent, délaissée ; un râteau appuyé contre un mur ; une tasse à café oubliée à terre, à côté d’une chaise, sur un perron ; un foulard souillé dans une flaque ; quelques mégots de cigarettes sur un même périmètre, chaque jour ; un journal dont les pages volent dans la rue, comme un drôle d’animal blessé ; une niche vide dans un coin de cour, triste et vétuste ; un gant oublié piqué sur une clôture. François ne se lasse pas de tous ces petits détails qui le touchent. Il essaie d’imaginer la vie des gens dont les objets sont comme des échos. Il voit des enfants grandis et partis depuis longtemps, des témoignages de présence dans l’oubli même d’objets ordinaires. Tous ces petits riens constituent un rappel du caractère éphémère de la vie et de son cycle sans fin.
François détache son regard du miroir et se passe de l’eau froide sur le visage. Il vieillit, il le sait bien, comme tout le monde. Il a l’impression que ses traits sont moins précis qu’avant, comme si l’artiste invisible qui reproduisait son visage dans le tain du miroir n’avait plus la main aussi sûre qu’autrefois. Ses cheveux ont des reflets plus clairs, annonciateurs de gris. Il sait aussi que son âme est plus vieille et plus meurtrie que son corps, pourtant déjà bien marqué.
François essuie son visage en soupirant. Il gagne le coin-cuisine, met du thé vert à infuser dans une tasse. Puis, il verse de l’eau froide dans une autre tasse et va arroser son arbre. Un bel orme. Une nuit, il y a de cela quelques années, peu après son retour définitif au pays, François était allé courir pour tenter d’exsuder ses souvenirs. Malgré la douleur dans sa hanche, il avait poussé son corps à son extrême limite. Ou peut-être en raison même de cette douleur. Il s’en était servi pour tenter d’oblitérer ses souvenirs. Les élancements et la brûlure dans son bassin et dans sa jambe lui avaient servi d’exutoire. Il avait concentré toute la force de son esprit sur sa souffrance physique immédiate, bien réelle, pour mieux effacer la souffrance rémanente de son passé. Ce ne serait peut-être que temporaire, mais tout valait mieux que de rester sans rien faire, à subir. Aussi avait-il couru dans les rues désertes de la ville endormie, couru jusqu’à ce que son mental cesse de le tourmenter. Après ce qui lui avait paru des heures, complètement épuisé, vidé par sa crise d’angoisse, il s’était arrêté pour reprendre son souffle, le coeur battant, les muscles vibrant sous la tension, la douleur comme un éclair blanc dans son esprit encore agité sous la surface. La sueur dégoulinait dans ses yeux et il l’avait chassée d’un revers de la main. C’est à ce moment-là qu’il avait vu, par terre, à ses pieds, contre la bordure du trottoir, des milliers de graines qui s’entassaient, poussées là par le vent. Des milliers de graines qui n’auraient jamais l’occasion de s’enfouir dans la terre et de donner naissance à un arbre. Des milliers de graines perdues et dont tout le monde se moquait. Des milliers d’âmes qui ne verraient jamais le jour. François avait senti une vague d’émotion monter en lui et l’emporter corps et âme. Renversé par le choc, il s’était laissé tomber à terre et s’était mis à pleurer. Il n’avait pas pleuré ainsi depuis son enfance, depuis le départ de sa mère. Les sanglots secouaient son grand corps et l’eau qui ruisselait de ses yeux n’était plus piquante et acide, mais salée et douce. Il ne voyait plus rien, ne sentait plus rien, n’entendait plus rien. Autour de lui, le monde avait disparu.
François ne savait pas combien de temps cette catharsis avait duré, mais quand il avait enfin réussi à reprendre le contrôle de son corps, l’aube pointait à l’horizon. La sueur avait séché sur sa peau et sur ses vêtements, la douleur refluait en vagues lancinantes et le froid le faisait frissonner. Il s’était relevé et, avant de rentrer chez lui, il avait ramassé une poignée de graines qu’il avait glissée dans sa poche. Puis il avait regardé autour de lui : il n’avait aucune idée de l’endroit où il se trouvait. Les rues, les maisons, tout lui était inconnu. Alors il avait marché, et marché encore, jusqu’à tomber sur un boulevard dont il connaissait le nom. Il l’avait suivi jusqu’à une station de métro, infaillible repère urbain. De là, il avait pu rentrer chez lui. Cette perte de repères avait été une sensation étrange, mais aussi étrangement familière. L’environnement n’était pas le même, mais le désarroi était une vieille connaissance. Alors il s’était raccroché aux graines entre ses doigts, au fond de sa poche. Elles étaient vivantes, elles méritaient d’avoir leur chance.
Le lendemain, il les avait semées. L’une d’entre elles avait germé, et François avait pris soin du petit arbre qui poussait, envers et contre tout, dans un pot, devant la fenêtre de son appartement en demi-sous-sol. Il l’avait arrosé, taillé, encouragé. L’arbre était devenu un confident silencieux, un ami à qui l’on peut confier ses joies et ses peines en vrac, sans avoir besoin d’ordonner ou de structurer ses pensées. François s’en occupait avec soin. Il avait vu le tronc prendre de l’épaisseur, les branches se déployer. Il ne connaissait rien à l’art du bonsaï, à part le nom, mais il aimait à faire le rapprochement entre son orme, bien modeste, et cet art ancestral. En tout cas, il y trouvait une certaine sérénité.
Extrait 2
Il y avait ensuite la maison de madame Plante, vieillotte mais soignée, tout comme sa propriétaire. La première fois que François avait sonné chez elle, il avait pensé que la maison était vide, comme beaucoup d’autres sur son trajet à cette heure de la journée. Le nom de son occupante ne laissait pas transparaître son âge, encore moins son occupation. Il lui semblait qu’autrefois, les facteurs savaient ces choses-là. Du temps de la jeunesse de sa grand-mère, le facteur du village n’hésitait pas à jeter un oeil à l’endos des cartes postales et à participer à la propagation des commérages en s’accoudant au bistro du coin. Bien sûr, c’était une époque où les gens écrivaient encore, puisque l’écriture était le principal mode de communication pour contrer l’éloignement. François avait bien conscience que cette époque était révolue depuis longtemps. Il se sentait vieux, parfois.
De toute façon, comme il allait l’apprendre, cela n’aurait rien changé. Il n’en aurait pas davantage appris sur la vie de Mme Plante. Son mari était mort depuis dix ans ; ils n’avaient pas eu d’enfants, et elle n’avait plus de famille proche. Personne ne lui écrivait, hormis les entreprises de démarchage et de vente par correspondance. Mais François ne savait encore rien de tout cela. La maison semblait tout simplement vide, silencieuse, presque feutrée.
Parfois, il apercevait un gros matou gris dans le jardin. Laid, une oreille presque arrachée, le corps magané, le chat le regardait passer, impassible.
Puis un colis était arrivé, et François avait sonné. Il avait attendu quelques instants devant la porte close, le vent du nord le faisant frissonner malgré son épais blouson. Par acquit de conscience, il avait sonné une deuxième fois. Une voix un peu chevrotante avait alors lancé : « J’arrive ! », et la porte avait fini par s’entrebâiller sur une vieille femme guère plus grande qu’une enfant et tout aussi frêle, qui l’avait regardé d’un air soupçonneux. Son uniforme avait paru la rassurer, et elle avait ouvert un peu plus sa porte. Son visage s’était éclairé en voyant le paquet, envoyé par un géant de la distribution en ligne. Elle l’avait pris dans ses mains tremblantes. On aurait dit que le poids du colis, pourtant léger, allait la faire chavirer vers l’avant. François avait eu envie de la soutenir mais, après l’avoir remercié, elle avait refermé la porte sans lui laisser le temps de réagir.
Le lendemain, il avait cru la voir derrière le rideau de sa fenêtre, qui le regardait passer. La semaine suivante, il lui avait livré un autre colis, quasi identique au précédent. Après cela, elle s’était mise à lui faire signe de la main quand il passait devant chez elle et qu’elle était à sa fenêtre, assise dans un grand fauteuil sur lequel le soleil de la fin de journée venait déposer ses rayons. François lui renvoyait son salut avec un sourire.
Bientôt, elle était devenue ce qu’il appelait une de ses « habitués ». Ceux qui étaient toujours là quand il passait : les retraités, les femmes au foyer, les sans-emploi, les travailleurs autonomes… François avait pris l’habitude de les saluer, d’échanger parfois un mot ou deux avec certains d’entre eux. Le chat gris magané faisait, lui aussi, désormais partie du décor. Il semblait veiller sur le jardin de Mme Plante avec l’arrogance indiscutable d’un roi sur son royaume. Sûr de lui, l’oeil mauvais, il surveillait le passage du facteur. Il respirait la certitude du plus fort. François doutait qu’aucun autre animal du voisinage ose le défier. Lui-même ne s’y serait pas risqué.
Un jour, François avait dû sonner de nouveau chez Mme Plante. Mais la vieille femme avait paru si fragile, voûtée, une toux caverneuse la secouant entièrement par moments, qu’il lui avait proposé de porter lui-même le paquet à l’intérieur. Elle avait hésité, avant d’accepter timidement. Pendant qu’il cherchait des yeux un endroit à portée de main où déposer l’envoi sans salir le plancher avec ses grosses chaussures sales et poussiéreuses, elle avait disparu dans la pièce d’à côté. Gêné, François dansait d’un pied sur l’autre quand il l’avait entendue lui demander :
— Entrez un instant, mon garçon. Vous prendrez bien un peu de café?
Et devant son air embarrassé, elle avait murmuré :
— C’est le moins que je puisse faire pour vous remercier.
Précipitamment, elle avait ajouté :
— Mais je ne veux pas non plus vous mettre en retard, vous pouvez partir, ne vous inquiétez pas. Ne faites pas attention à moi…
François avait eu une drôle de sensation dans la poitrine, comme un resserrement. Elle l’émouvait. Il avait soigneusement posé le colis devant lui, ôté ses chaussures, puis il s’était avancé vers la vieille femme :
— Avec plaisir, madame Plante. Je peux vous aider avec les tasses, peut-être?
Sa main s’était figée à mi-chemin d’un placard, et la surprise s’était peinte sur son visage. Puis, après quelques secondes de silence étonné :
— Suis-je bête! C’est vrai que vous connaissez déjà mon nom.
Et, lui tendant la main :
– Je m’appelle Madeleine. Madi pour mes amis.
« François », avait-il répondu en prenant garde à ne pas trop serrer cette main si frêle et tavelée dans la sienne, épaisse et calleuse.
Et c’est ainsi que tout avait commencé.
Extrait 3
La première fois que le vieux matou a aperçu François, il s’est prudemment reculé dans un buisson de fleurs afin que l’homme ne puisse pas le voir. Il va sans dire que le matou avait déjà vu des facteurs. Il reconnaissait bien la sacoche et les gestes de ce rituel humain fort étrange qui consiste à déposer des choses fragiles, pliables et surtout non comestibles dans des boîtes en hauteur, devant chaque porte du quartier. Une routine quelque peu incompréhensible, mais il en avait vu d’autres. Il se méfiait surtout de l’arrivée de cet inconnu, qui dégageait une force et une émotivité qu’il valait mieux observer de loin. Un peu trop souvent à son goût, le matou avait été chassé par des cris, accompagnés de coups de pied ou de pierres lancées dans sa direction. Les projectiles atteignaient rarement leur cible, car il était rapide, mais c’était fort désagréable. Et il savait bien qu’il était inutile de cracher ou de gronder, l’intimidation ne faisant qu’exacerber la colère des humains. Prudent, il se cachait donc.
C’est ainsi qu’il a regardé François s’approcher, de sa démarche claudicante. Il a aussitôt perçu sa souffrance.
Il s’est aplati sur le sol, et ses yeux n’ont pas lâché l’homme avant qu’il ait disparu au coin de la rue, son offrande de papier faite au monstre métallique de la porte. Puis le matou s’est approché de la maison, a souplement sauté sur le rebord de la fenêtre et coulé un regard à l’intérieur, avec circonspection. La gentille vieille dame était là, tout allait bien. Le matou est retourné vaquer à ses occupations.
Les jours suivants, il a guetté François, et sa curiosité a grandi. Cet homme n’était pas comme les autres : il regardait les arbres, posait parfois une main sur leur tronc. Il s’approchait des fleurs pour les sentir. Cette attitude était peu courante chez les humains, ordinairement toujours pressés, marchant la tête baissée sur ce drôle d’appareil rectangulaire qui ne les quittait pas et sonnait ou bipait constamment. Le matou soupçonnait que les pauses que marquait l’homme lui étaient nécessaires. Il ne pouvait pas savoir que François reposait ainsi sa hanche, pour tenter de calmer ses élancements. Par contre, il savait intuitivement que cet homme était un guerrier, comme lui, et qu’il était marqué par ses combats. Le poids des affrontements pesait sur ses épaules. Le matou sentait l’assurance se mêler à la peur, le calme à la tension. Malgré les apparences, rien n’était habituel chez cet être-là.
Après plusieurs jours d’observation prudente, le matou est resté, un matin, couché sur la pelouse devant la maison de madame Plante. Il a regardé passer l’homme sans bouger d’un pouce, l’air impassible. Il était temps de lui faire savoir qu’il était ici sur son territoire. Personne ne l’en délogerait. L’homme a ralenti son pas, lui a rendu calmement son regard, mais n’a pas tenté de s’approcher pour le chasser ou le caresser. Cela ne faisait que confirmer au matou ce qu’il pressentait déjà : cet humain appartenait bien à une classe à part.
Quand François est entré pour la première fois chez la vieille dame, le matou a tendu l’oreille, sondé l’air de ses moustaches, préparé ses griffes. Mais il ne s’est rien passé de notable et, au fil des jours, il a senti que la tristesse de la vieille femme s’éloignait quand l’homme était là. Elle semblait même l’attendre. Le matou sentait sa fébrilité. Solitaire par nature, il ne comprenait pas ce besoin de compagnie, mais il l’acceptait, comme il acceptait que la vieille femme le caresse quand elle lui donnait à manger.Ce premier jour, rempli de curiosité, il a fini par monter s’installer derrière la vitre, témoin silencieux du nouveau rituel qui s’établissait entre ses deux humains. Il a écouté l’homme parler, il a vu sa vieille amie fermer les yeux pour mieux se laisser porter par sa voix. Et le timbre grave et expressif du facteur, qui faisait doucement vibrer l’air, a bientôt gagné le chat. Il a baissé sa garde et ses paupières se sont closes.
Au fil des jours, presque à son insu, il s’est mis, lui aussi, à attendre les visites de François. Au bout d’un certain temps, il a finalement décidé que le facteur faisait désormais partie de son univers. Un beau jour, il est donc venu à la rencontre de l’homme quand celui-ci a pénétré sur son territoire, et il l’a escorté jusqu’à la porte de madame Plante avant de prendre son poste sur l’appui de fenêtre, en attente de la suite des choses, comme si de rien n’était. Le facteur a hoché la tête et l’écho de son sourire est remonté jusque dans ses yeux.
Fractales, haïkus visuels (extraits)
La terre me parle du temps qui passe, des rêves qui naissent et s’évanouissent, de nos espoirs qui déploient leurs ailes translucides, des Hommes trop pressés, des vies qui défilent et des morts qui en constituent la trame. Je l’écoute en silence.
si dense
le silence de la nuit
je retiens mon souffle
***
traduction libre de l’univers
en écriture alchimique
sur les écorces des arbres
Le temps passe et les rêves fluctuent, traversés par des éclats de lune et d’étoiles, portés par des créatures magiques et improbables qui, toujours, se délitent dans l’entre-deux du petit matin, ce temps hors du temps, entre veille et sommeil, rêves et réalité, conscience et détachement. Le monde tourne et les étoiles dansent, mais seuls ceux qui savent encore rêver le perçoivent.
***
Cette nuit, deux étoiles se sont croisées; se sont reconnues. Elles ont rêvé, ri et pleuré, et le ciel tout entier a remué dans son grand sommeil, recouvrant la terre d’une chape lourde, faite d’espoirs autant que de regrets, doux écho de cette rencontre stellaire, collision de rêves, éclats d’illusions, chocs de mondes oniriques… J’ouvre grand les yeux et j’inspire l’immensité du monde – des mondes – à grandes goulées avides.
entre chien et loup
sous mes pas le reflet
des étoiles
***
Autour de moi, l’automne et l’hiver se font concurrence, entre pluie et flocons, humidité et vent mordant. Imperturbable, je me fais témoin de cette lutte sans cesse renouvelée, collision d’une fin et d’un commencement, d’une mort inéluctable et d’un long repos, suspension de temps, silence entre deux notes, entre deux mesures. Les jours se font fuyants, la nuit les écrase de son manteau si lourd, couverture molletonnée qui enveloppe le monde et donne aux étoiles tout leur éclat. Des créatures étranges glissent leurs confidences au creux de notre sommeil, d’une voix si légère qu’elle pénètre nos rêves et entrebâille la porte de nos âmes. Quelques gouttes de la magie oubliée des temps anciens s’y coulent doucement, faisant tressaillir brièvement nos corps inconscients. Et si ces murmures presque inaudibles étaient la clé de notre mélodie, celle qui se cache depuis si longtemps au fond de nos iris, miroirs de l’univers?
Je cligne des yeux, et le temps reprend son cours.
forêt d’automne
le silence s’invite
au fil de mes pas
***
Dans la forêt, d’étranges créatures difformes, gardiennes des entrées cachées sous les écorces et dans les entrelacs des branches, me suivent des yeux, sondent mon âme et creusent mon corps, jusqu’aux tréfonds de mes cellules. Elles savent qui je suis, si moi je ne le sais pas toujours. Mon ADN est inscrit dans l’univers, dans le vent et la terre, et je ne peux leur échapper…
petit matin
un dernier lambeau de nuit
assombrit l’étang
***
La noirceur tombe tel un rideau sur la fenêtre de mes envies. Je divague. J’extravague, plutôt. L’univers retient son souffle, pris dans un entre-deux, une non-saison, piégé sur une ligne sans retour. Je cherche la circularité, l’équilibre, le vide. J’écoute le battement intermittent du cœur du monde, si puissant qu’on ne l’entend plus, si ténu qu’il nous fait frissonner. Et mes rêves reprennent.
tai ji au parc
la vieille dame et son chien
bougent avec lenteur
© Julie Turconi
Montréal, au fil du temps
© Julie Turconi
Montréal, le 8 août 2008
Trying to save ’em all
Before the clouds become too tight
And heavy and thick
Till there’s nothing more than stars in my eyes
And the whole universe in my heart.
Dawn of the world in my hands
Sunrise in my soul
All of it contained
They whispered the world to me
As if it was meant to be.
I’m no stranger to chaos
But from my emptiness came light
And hope and misery and life
I traveled through it all,
Full of what should be.
No wonders in the realm of gods
No miracles in the flames of heaven
And the iciness of your soul
Bring only what your hands can’t grasp
No matter what you thought could be.
Humanity is your gift,
And no one can take it from you.
Dream, breathe and cry,
You’re my always, ever and never,
Everything that is.
© Julie Turconi
Montréal, le 14 janvier 2013
Images fugaces et dérangeantes d’un rêve qui se délite…
Cauchemar de X5 peut-être (voir « Dark Angel ») ou métaphore de notre humanité.
L’homme marche, droit devant lui, à pas tellement pressés qu’il en court presque. Sa silhouette floue, tâche grise dans la brume, progresse inlassablement. Il marche sans un regard en arrière, tendu vers son but, les bras crispés sur les côtés de son corps, les jambes raides. Il semble fuir, mais avec prudence, en économisant ses forces, son souffle. Il ne veut à aucun prix être rattrapé, ni se retrouver aux prises avec ce qu’il fuit. Cette ombre, cette chose sans nom qui n’abandonnera jamais, il le sait bien. La menace pèse sur ses épaules, palpable, lourde et étouffante. Il ne doit pas s’arrêter, pas même – surtout pas ! – pour jeter un œil par-dessus son épaule. Il transpire, il halète, mais il tient bon.
Soudain, devant lui apparaît une autre forme, elle aussi en mouvement. Dans la même direction que lui. La silhouette se précise peu à peu, car l’homme gagne du terrain. Il a peur. Et celui qui le précède, quel qu’il soit, a peur aussi, il le sent. Il se met à courir, il doit rattraper cet individu. Il accélère, chasse la sueur qui coule sur son visage, pique ses yeux écarquillés, le glace au plus profond de son cœur. Quand, enfin, il réduit suffisamment l’écart qui les sépare, il s’aperçoit que c’est un enfant qui fuit devant lui. Un enfant terrifié, qui trébuche, manque tomber en le découvrant si près.
« Ne t’inquiète pas, gamin, je ne te suis pas. Je rentre chez moi. » Il force sa voix à rester calme, apaisante, assurée. Il ne veut surtout pas faire peur à un enfant. Mais il n’a pas le temps de lui demander ce qu’il fait là, tout seul, paniqué. Pas le temps de s’occuper de quoi que ce soit, si ce n’est de ce vers quoi il avance. De ce qu’il fuit.
L’enfant dépassé, abandonné, il ralentit, reprend son rythme, entre marche et course. Il ne doit pas se fatiguer, il ne sait pas combien de temps tout cela va durer.
C’est alors qu’il remarque que le paysage, autour de lui, a changé. La brume s’est écartée d’eux, de lui, et il avance maintenant le long d’un couloir sombre, au sol de terre battu. Ce couloir, il le connaît, c’est celui qu’il ne peut quitter, celui sur lequel il retombe, encore et encore. De nouveau, il se jette en avant. Il court, affolé, à court d’air et d’espoir. Le couloir défile autour de lui, sans fin. Un couloir éclairé en contre-haut par des ouvertures qu’il n’ose qualifier de fenêtres. Des trous par où la lumière bataille pour percer dans ce monde de ténèbres. Son monde, depuis toujours. Des barreaux empêchent toute fuite vers le haut, vers le dehors, vers la lumière. Il n’essaye même pas de sauter, de s’agripper, il sait que ça ne sert à rien. Il est revenu en prison.
Derrière lui, il entend – il sent – les pas se rapprocher de plus en plus. La chose comble son retard, inexorablement. Pour la première fois, il cède à sa peur et se retourne. Un bref instant, si bref que le temps s’est arrêté. Mais il ne voit rien, que le noir et la poussière que chacun de ses pas soulève sur ce sol inégal. Quand il se retourne, tout a changé. Sa perception est modifiée. Plus étroite. Et c’est un enfant qui se remet en marche. Un enfant aussi terrifié que celui qu’il a croisé plus tôt. Un enfant aux vêtements sales, aux cheveux en bataille, au visage couvert de terre. Un enfant au regard de fou. Sur sa gauche, les cellules, enfin. Il les dépasse, l’une après l’autre, toutes désespérément fermées, verrouillées. Là, une ouverture, un trou béant à la place d’une porte. Instinctivement, il bifurque et s’engouffre dans le gouffre, dans cette cellule aussi noire que l’enfer, qui l’appelle. La sienne ? Il se jette vers le fond, contre le mur. Il grimpe en s’écorchant les doigts. Là-haut, il sait qu’il pourra sortir, maintenant qu’il n’est plus un adulte.
Il se glisse entre les barreaux de bois, rampe, aspire la lumière. Il manque de s’étrangler, s’écroule, tousse. Pas maintenant, il ne doit pas rester là, la chose est toujours après lui, il faut se relever, se remettre à courir, à fuir. Une main autour de la gorge, comme pour s’aider à respirer, il prend appui sur l’autre, se redresse et bondit en avant. Dehors. Il y est presque, il le sent. Mais la lumière l’éblouit, le repousse, c’est un véritable mur sur lequel il butte. Il doit changer de direction, mais continuer à avancer à tout prix. Quitte à revenir sur ses pas. Il n’a pas le choix, il est perdu et la seule issue est de retourner d’où il vient. Là où sa fuite a encore un sens.
En prison.
Mais il n’est plus dans la même section, tout est différent ici. Il ne reconnaît rien, ni le béton, ni le gris, ni les murs. Il n’en peut plus, l’épuisement le gagne. Il s’appuie un instant au mur et constate, horrifié, que sa main est celle d’un vieillard, toute ridée, tachée. Son corps, lui aussi, a changé, il le sent sans avoir besoin de regarder. Il sait que l’enfant a disparu, enfui dans les brumes du dehors et de l’espoir. Ici, il n’y a rien pour lui. Il a perdu et il le sait. Pourtant, envers et contre tout, sa volonté ne faiblit pas, elle le porte en avant. Elle le maintient debout. Depuis si longtemps qu’il fuit, il ne peut pas s’arrêter maintenant. La chose va le rattraper, mais qu’importe à présent ? Il n’est plus rien ou presque.
Soudain, un tournant. De l’autre côté, un homme se dresse face à lui. Un homme qui n’est pas ce qu’il fuit, mais qui n’en reste pas moins une menace. Car le vieillard l’a reconnu : cet homme, c’est un savant, celui-là même qui conduit les expériences sur les enfants. Des souvenirs lui reviennent, en éclairs aciers et acérés. Inox, métal, murs, douleur. Il ne sait plus exactement ce qui s’est passé, il n’est plus très sûr qu’il se soit jamais passé quoi que ce soit et qu’il n’est pas simplement en train de devenir fou, mais il est terrassé par la force de ce retour vers ce qu’il a – peut-être – été autrefois. Il y a si longtemps. Est-ce cela qu’il fuit ? Cette chose sans nom, est-ce lui ou une partie de lui ? Et pourquoi retrouver le savant ici, aujourd’hui ? Le vieillard, perdu, bloqué dans son pitoyable élan, courbe l’échine. Le savant, immobile, contemple un long moment ce vieil homme fini, à moitié fou, tremblant et décharné. Puis il soupire : « Quelle importance ? Tu n’es qu’un prototype, complètement obsolète. Tu ne sers plus à rien. Tu n’es plus rien. On fait bien mieux aujourd’hui. »
Le savant prend le vieillard par le bras et l’entraîne doucement avec lui. Le vieillard suit, sans même relever la tête, le poids de son destin affaissant ses frêles épaules. Il n’a pas vu la lueur fugitive dans les yeux durs et sombres du savant, reflet d’un sentiment inhabituel en ces lieux, un sentiment qui n’y a pas sa place. Une lumière bannie, indésirable. Pourtant, elle éclaire faiblement alentours. C’est une sorte de halo, une irradiation qui semble provenir de l’intérieur même des murs qui les enferment. Mais le vieillard, perdu en lui-même, ne la voit pas, ses yeux aveugles à tout ce qui l’entoure.
Le savant ralentit à peine devant les gardes, il se contente de leur adresser quelques mots, péremptoires. Après tout, il est aussi payé pour entretenir les apparences et il faut bien justifier leur présence, ici, à cet instant. Ne serait-ce qu’à ses propres yeux. Il dit que le vieux fou est le grand-père d’un des gamins et qu’il n’a rien à faire ici. Plus maintenant. Jamais. Les gardes s’écartent, indifférents. Leurs ordres sont de stopper les enfants. Juste les enfants. Le reste ne les concerne pas.
Sans un mot à son égard, le savant pousse le vieillard dans la lumière et le regarde s’éloigner, l’air égaré. Cet homme est condamné, il le sait. Pour lui, il n’existe aucun autre choix que celui de continuer à fuir au-delà de toute peur, au-delà de cette chose sans nom qui pourrait bien être lui-même. Une fuite éperdue, aussi vitale que sa propre respiration.
Une fuite, oui … mais vers quoi ? Il n’y a rien, nulle part, pour ceux de son espèce.
© Julie Turconi,
Montréal, le 20 décembre 2008
[Ab irato : « par (un mouvement de) colère » en latin]
Assise derrière sa fenêtre, immobile, elle regarde dehors. Les yeux vides, comme deux étendues d’eau sombre et marécageuse, zébrées d’éclats verdâtres. Ses paupières clignent à intervalles réguliers, seul signe de vie dans ce visage inexpressif. Quelque passant dans la rue qui lèverait le regard vers sa fenêtre ne distinguerait probablement qu’une silhouette aux contours incertains, une poupée de cire grandeur nature, très pâle, comme éthérée.
Le jour tombe, la lumière a cette consistance particulière qui fluidifie toutes choses, les rend floues, indistinctes. Tout est encore possible, et pourtant tout est déjà mort.
L’appartement semble vide, comme si aucune présence n’habitait ces lieux. Une pièce unique, faisant office de salon, chambre à coucher, salle à manger. Une petite cuisine où la poussière recouvre tout, même les assiettes qui trempent dans l’évier. L’eau grisâtre se pare d’une fine pellicule triste, qui noie la crasse, la rend presque invisible. Une minuscule salle de bain, aux murs d’un beige passé, douteux. Pas d’objets personnels, de souvenirs, de photos. Aucun visage souriant pour égayer cette solitude désespérante.
La chaleur écrase le décor, fait vibrer l’air pourtant immobile.
Elle est à sa fenêtre et regarde dehors. Elle ne voit rien. Rien que l’habituelle cour de béton fissuré et son grillage troué, aussi inutiles l’un que l’autre, qui bordent l’immeuble en une vaine tentative pour l’isoler de la route, tout là-bas, en contre-haut. Ou peut-être, au contraire, pour isoler la voie de circulation de la cité, bâtie bien après que l’itinéraire routier ait été décidé, tracé, construit ?
Le bruit est incessant, elle le perçoit même la fenêtre fermée : les moteurs vrombissent, les pots d’échappement crachent leur fumée mortelle, les jurons claquent dans l’air sec de cette fin d’été. Embouteillage, retour de vacances. À tout le moins pour ceux qui auront eu la chance de partir, de quitter la banlieue grise pour fuir vers un ailleurs plein d’espoir. Pour quelques jours, ou quelques semaines. Elle sait en son for intérieur que cet ailleurs ne vaut pas mieux qu’ici, maintenant. L’air y est le même, vicié et chaud. Les gens s’entassent entre leurs quatre murs chèrement payés ou sur le sable maculé et souillé d’une plage morose, sur laquelle viennent s’écraser des vagues trop paresseuses ou trop déprimées pour monter bien haut. La vie, sans pitié, lui a appris que quand on n’a pas d’argent, il vaut mieux rester chez soi. Tous ces vacanciers reviendront fatigués et insatisfaits ; pourtant, ils afficheront un enthousiasme mensonger pour cette liberté illusoire et éphémère. Ils montreront des photos qui se ressemblent toutes à qui veut bien les voir. Parents, famille, amis. Elle n’a rien de tout cela.
Plus personne ne vient la voir. Depuis longtemps. On l’a oubliée, tassée dans son coin. Dans le dénuement et la maladie. Elle s’en fiche, rien de tout cela n’a d’importance car personne ne comptait vraiment. Personne ne compte plus. Tous ces gens bien intentionnés, trop pressés de se débarrasser d’elle, qui se disaient de sa « famille » et qui voulaient l’envoyer dans un centre quelconque. Un mouroir. Elle s’est défendue, avec rage, et elle a encore toute sa tête. Ça, au moins, ils n’ont pas pu le lui enlever. Bien sûr, les services sociaux viennent régulièrement la voir pour essayer de la convaincre qu’elle serait mieux ailleurs, mais à eux aussi elle sait tenir tête. Qu’ils se contentent de lui verser sa pension, après tout elle a travaillé pour ça, il est temps que la société lui redonne un peu de ce qu’elle lui a pris. Toutes ces années… Elle s’est toujours débrouillée, ce n’est pas aujourd’hui que les choses vont changer. Personne ne prendra son destin en main. Si elle doit mourir – et elle sait qu’elle va bientôt mourir – ce sera chez elle. Dans cet appartement qu’elle a toujours connu, cette cité où plus personne ne viendrait vivre de son plein gré. Ceux qui atterrissent ici n’ont pas le choix. On ne sait où les mettre.
*********
Elle regarde dehors, où les lumières s’allument, les unes après les autres. Aux fenêtres, sur les lampadaires qui n’ont pas été brisés par les gangs de rue. Il fait toujours aussi chaud, l’air est moite. Quelques jeunes passent en s’invectivant, dans la cour désertée. Les mères de famille ont rentré leurs enfants depuis longtemps et se sont cadenassées chez elle. Beaucoup n’ont pas d’homme pour les protéger, d’autres aimeraient mieux ne pas en avoir. Les coups, les cris, les bleus, c’est le quotidien de la cité. Comme si la grisaille descendait sur les cœurs, recouvrait l’âme même des habitants de ces blocs tristes, aux murs recouverts de graffitis, aux portes enfoncées, aux vitres sales ou brisées.
Elle sait tout cela, elle a vu sa cité partir en morceaux, brûler dans les flammes de l’enfer moderne. Mais elle n’a rien dit, rien fait. Que pouvait-elle dire ou faire, de toute façon ? Une vieille dame ne compte pas, ne compte plus. Les jeunes ne l’embêtent pas parce qu’elle leur fait peur, avec ses silences lourds, sa fragilité spectrale, ses yeux vides. Surtout ses yeux. Trop sombres, trop perdus. Leur éclat a disparu à jamais. Comme si le néant l’avait emporté, effacé. Elle le sait bien, et parfois s’en félicite, car la peur qu’elle instille est sa seule protection. Sa seule arme.
Parfois, elle pleure et voudrait en finir.
*********
Elle est à sa fenêtre et regarde dehors. Cette nuit, la lune daigne se montrer dans le ciel habituellement bouché par la pollution. Les étoiles sont fades, presque invisibles. L’air ne s’allège pas, la chaleur pèse sur le bitume. Elle entend des cris, de l’agitation. Des bruits de destruction, des coups sourds, des éclats tranchants qui strient l’air. Énervement de jeunes qui n’ont rien à faire qu’à crier leur haine et leur rage à la face du monde. La pauvreté, le rejet et l’attitude de la « bonne société » à leur égard leur fait perdre tout contrôle. Ils n’ont plus rien à perdre. N’ont jamais rien eu à perdre, excepté leurs âmes. Ces jeunes se sentent victimes du monde, piétinés, foulés aux pieds, ignorés. Elle n’est pas de ce temps, de cette époque ; elle se sent dépassée, ne comprend pas leurs réactions, leur révolte. Elle trouve leurs actions vaines, illogiques. Pourquoi ne pas choisir les armes même de la société, celles par qui les écarts se creusent ? La culture, la connaissance. La manipulation des esprits. Seuls les forts s’en sortiront, les autres sont appelés à s’écraser, ramper, se cacher. Il en a toujours été ainsi. Plus les temps changent, moins les choses changent. Et cet été qui n’en finit pas n’arrange rien ; la chaleur dilue les consciences, abolit tous les principes, englue les cerveaux. Les cœurs sont en ébullition, la cité est sur le point d’exploser. Une véritable bombe. Elle le sent.
Dans un éclair de nostalgie désespérante, elle repense à sa jeunesse. Qui a fui sans prévenir, un jour lointain. Elle se sent vieille depuis si longtemps. Fermée à la vie, aux rires et à la société. Vieille et seule. Son unique compagnie, ce sont les enfants qui passent devant sa fenêtre et jouent dans la cour. Ces enfants de toutes les origines, de toutes les couleurs. Qui ne la voient jamais, ni ne lui sourient. Mais elle les voit, les regarde. Et pense à tout ce qu’elle aurait pu vivre, si l’accident n’était pas arrivé. Un autre été, lointain. Moins chaud.
Regrets délavés par le temps, presque disparus aujourd’hui. L’heure se rapproche.
*********
Dehors, la lune éclaire la cour, vaste étendue rongée par le temps. Le temps qui fissure et fait craquer le béton, laissant à la nature une faible espérance de victoire. Mais seules les mauvaises graines arrivent à survivre ici, dans cet environnement irrémédiablement abîmé, où même les voitures ne sont guère plus que des carcasses de tôles en devenir. Les quelques arbres plantés par la ville, des années auparavant, n’ont pas réussi à croître, à se développer. Ils végètent, rachitiques, passifs. Comme si le désespoir leur minait le cœur, à eux aussi.
Tout est altéré dans la cité, sans espoir de rémission.
Perdue dans ses pensées, ses souvenirs, ses regrets peut-être, elle regarde dehors. Toujours immobile, figée comme l’air, comme le temps. En suspens. Puis sa main se met à trembler, sans raison apparente ; un frémissement irrépressible. Elle sent la chair de poule hérisser les poils de ses bras, tendre sa peau ridée, fripée. Elle a peur. Quelque chose est dans l’air, dehors. Un bruissement presque palpable, comme si l’air lui-même se texturait, se densifiait. Au-delà des cris, des altercations habituelles. Ce soir, tout est trop… exagéré, altéré. La cité et sa violence puissance dix.
Un sursaut de crainte, incontrôlable, et elle voudrait appeler. Appeler à l’aide. Mais qui ? Les représentants de la loi ? Ça fait bien longtemps qu’ils ont cessé de se préoccuper d’eux, de leur monde. Que les délinquants s’entretuent, tant qu’ils restent dans les limites de la cité. Quelle importance ? Pour la société du dehors, celle qui vit dans de belles maisons protégées, entourées de verdure et de gardes armés, c’est mieux ainsi. Laissons la vermine croupir et mourir dans son marécage.
Elle tremble de plus belle.
Sous l’effet de la peur, son regard s’est allumé, un certain éclat est revenu au fond de ses prunelles élargies. Son intuition ne l’a jamais trompée. Il se prépare quelque chose. De bien trop grand, bien trop fort pour elle, pour eux tous. Puis ses yeux se voilent de nouveau, deux étendues liquides et vides. Tout est fini. Pour elle comme pour les autres. Dans le fond, c’est mieux ainsi. Elle est prête, tout effroi l’a quittée.
*********
Une explosion. Suivie par une autre, puis une autre. La révolte gronde, enfle, si rapidement et si violemment qu’elle n’est bientôt plus qu’une seule voix. Haineuse. Désespérée. Les déflagrations s’enchaînent. À l’infini. Le ciel crépite de lumière, de flammes, de feu. Les murs s’embrasent, les voitures se transforment en torches, en armes mortelles. Les pleurs et les cris envahissent l’air saturé de chaleur, d’électricité. C’est comme si l’été lui-même explosait d’un seul coup.
Les éclats de verre brisé luisent sous la lune, sur le bitume. La guerre est déclarée.
Le temps de l’horreur peut commencer.
*********
Quand ils ont défoncé sa porte en hurlant, elle n’a pas bougé. Pas même un battement de paupière. Elle semblait déjà morte. De l’intérieur. Ils se sont arrêtés sur le seuil, d’un coup, figé par le spectacle de la vieille femme en fauteuil roulant, immobile près de sa fenêtre sale, miraculeusement épargnée par les projectiles. La lumière dansait sur les murs, des éclairs blancs zébraient la peau parcheminée de la vieille femme, faisaient luire bizarrement ses yeux perdus. L’effarement les a gagnés, tous. Puis la peur a dédoublé la rage, la haine a repris le dessus, trop longtemps retenue, et ils ont déferlé dans l’appartement. Résolus à ne rien laisser derrière eux.
Un coup de feu a éclaté, la balle lui a traversé le crâne, emportant la moitié de la cervelle avec elle. Trace brunâtre et gluante sur le mur. La vieille souriait.
*********
Cette nuit-là, tout a brûlé dans la cité. Dans ce déchaînement de colère brute, animale, tout a été effacé. L’armée a entouré la cité, bloqué toutes ses issues, abattu à vue tous ceux qui essayaient de s’en échapper. Sans distinction, sans sommation. Victimes et bourreaux. Innocents et assassins.
Pendant des mois, l’air a suinté de chaleur, de bruit et de fureur. La fumée a fini par se tarir, mais les cendres et la poussière de la mort ont continué à monter des décombres longtemps après cette funeste nuit. Les morts, eux, pourrissaient dans l’oubli. Personne ne les a réclamés. Personne n’a pleuré la vieille femme.
*********
Plus tard, beaucoup plus tard.
À l’entrée de ce qui a autrefois constitué la cité, près des restes des immeubles dévastés, un panneau résiste à l’usure du temps ; il tient encore à moitié debout, tordu mais bien visible dans ce paysage désolé où rien n’a jamais repoussé. De la route qui contourne toujours ce site maudit, on n’aperçoit guère que sa silhouette mince et harassée. Il faut être bien téméraire pour descendre et s’approcher, afin de mieux voir.
C’est un vieux panneau d’antan, abîmé, noirci, presque illisible. Sous les tags et les traces de brûlure, on distingue encore ces mots : « Cité des Aulnes verts ».
Vert comme l’espoir.
© Julie Turconi
Montréal, le 27 décembre 2006
Le vieil homme était assis, courbé, voûté, sur un banc décrépi du jardin public situé en bas de chez moi, en plein cœur de la ville. Une ville comme toutes les autres, grande, grise et polluée, mais qui recelait des merveilles pour ceux qui savaient encore regarder. Comme ce petit jardin aux grilles joliment ouvragées malgré les ravages du temps, au centre d’une vieille place pavée, quelque part dans le quartier de M…, perdu entre boulevards et lignes de métro.
J’aimais bien me promener dans ce parc, par tous les temps, en toutes saisons. Cet endroit avait pour moi un charme spécial, le charme suranné des lieux presque abandonnés. Oublié des hommes et de la modernisation. Bien sûr, les grilles étaient avachies, la peinture écaillée, la végétation redevenue sauvage et folle. Le vieux manège de chevaux de bois, autrefois dorés, ne tournait plus depuis longtemps. Mais j’aimais à imaginer que je pouvais remonter le temps, et me replonger dans l’atmosphère que ce jardin avait pu avoir à sa belle époque.
Un jour j’ai croisé ce vieil homme. Un « sans domicile fixe », un itinérant de plus, devaient penser les gens qui passaient par ici et qui l’apercevaient, loqueteux et sale, sur son banc. Car je découvris très vite qu’il s’asseyait toujours au même endroit, sur le même banc. Face au manège endormi. Les yeux dans le vague, il semblait rêver. Un sourire flottait parfois sur ses lèvres, une mélodie montait doucement dans les airs. Un air entraînant, que je ne connaissais pas.
Intriguée, fascinée, je me suis approchée. Je me souviens qu’il faisait gris ce jour-là, humide et froid. Je lui ai offert une tasse de café, achetée sans arrière-pensée consciente quelques minutes auparavant en passant au bar du coin de la rue, qu’il a acceptée d’un signe de tête, sans dire un mot. Son regard suffit à me remercier. Je me suis assise en silence à ses côtés et j’ai sorti un paquet de gâteaux secs de ma poche. Il paraissait un peu étonné de ma présence, mais sans en être gêné. Ce jour-là je n’ai rien dit. Nous n’avons pas échangé la moindre parole.
Je suis revenue le lendemain, puis le surlendemain, et ainsi de suite. Petit à petit, nous sommes devenus amis. Comme ces très vieux amis qui n’ont plus besoin de se parler, qui se comprennent d’un simple regard. Quelques jours avant Noël, comme le temps se mettait au froid, je lui ai offert une écharpe, bien chaude. Alors il m’a dit merci. C’était la première fois que j’entendais sa voix autrement qu’en fredonnant. Elle était chaude et grave, un peu cassée, comme rouillée, mais je la devinais puissante. Je l’ai invité à dîner, chez moi pour le réveillon. Il a doucement secoué la tête, un petit sourire au coin des lèvres. Il m’a expliqué que sa vie était là, dehors, et qu’il ne voulait pour rien au monde être ailleurs. Je suis repartie sans insister.
Le soir du réveillon, seule et déprimée, je l’ai rejoint sur son banc, dans ce parc hors du temps. Nous avons partagé les petites douceurs que j’avais amenées, puis nous avons contemplé les étoiles qui scintillaient tout là haut dans le ciel nocturne. Aucun nuage n’assombrissait la voûte. Le froid était mordant. Mais les étoiles semblaient briller plus fort pour nous, comme des guirlandes lumineuses qui traçaient de grands dessins étranges venus d’un autre monde. La Grande Ourse, le Sagittaire, Vénus… et tant d’autres, que notre imagination créait au fur et à mesure.
Tout d’un coup il s’est mis à parler. A me raconter sa vie. Je l’ai écouté sans bouger, de peur de rompre le charme. Et j’ai oublié le vent qui me glaçait les os.
Autrefois, il y a très longtemps, m’a-t-il dit, il était un gamin d’itinérant, un forain. Un Rom comme disaient les autres enfants. Sa famille avait toujours été nomade, parcourant le monde au gré de sa fantaisie, donnant des spectacles ici et là. Jongleries, acrobaties, clowneries… une sorte de cirque amateur, plein de poésie, qui faisait la joie des tous les enfants de tous les pays. Qui amenait l’imaginaire et le merveilleux dans le cœur des gens. Sur les marchés et les foires, dans les festivals et les fêtes locales, de villes en villes et de villages en villages, partout où leur art était le bienvenu.
Lui aimait surtout raconter des histoires, qu’il glanait à droite à gauche, au gré des divagations de son esprit. Ou encore des contes venus de son pays d’origine, très loin là-bas vers l’Est, par-delà les mers et les montagnes. Un pays qu’il n’avait jamais vu mais que sa grand-mère lui racontait le soir avant qu’il ne s’endorme. Des récits d’aventures, fantastiques et poétiques, remplis de créatures étranges, de magie, de braves chevaliers. Il avait le don d’envoûter son auditoire, de le faire rentrer dans ses histoires, de le faire vibrer…
En grandissant il développa son art, ce cadeau merveilleux dont les fées ou quelque lutin magique au nom étrange et inconnu lui avaient fait présent à sa naissance. Il devint une attraction à lui tout seul, tenant le devant de la scène tous les soirs.
Un grand feu de camp, un brasero, dans un champ, un terrain vague ou simplement au milieu d’une rue, quelques bancs de bois grossièrement taillés placés en demi-cercle, et le décor était planté. Les flammes créaient une atmosphère propice aux récits, elles faisaient danser la lumière sur son visage rude qui s’animait, se déformait, se tordait sous l’emprise de ses personnages. Il était devenu conteur, et n’aurait pu imaginer être autre chose.
Sa vie s’écoula ainsi. Les recettes étaient plus ou moins bonnes, la nourriture pas toujours en abondance, mais il était heureux. Les saisons se succédaient, aux froides nuits d’hiver se substituaient celles, plus douces, du printemps, dont les chauds soirs d’été prenaient à leur tour la place. Mais les temps changeaient. Insensiblement, inexorablement. Partout le modernisme gagnait du terrain, la vie des gens devenait plus facile, plus pratique. Ceux-ci perdaient petit à petit le besoin et le goût du merveilleux, de l’imaginaire. Sans même s’en apercevoir. Car tout était désormais concret, expliqué, démontré. On était entré dans une ère scientifique et pragmatique. Personne n’avait plus le temps de s’attarder sur des choses futiles comme le rêve. Le progrès gagnait du terrain. Les cœurs se fermaient à la poésie. La vie devenait organisée, programmée, et l’art sous toutes ses formes était maintenant enfermé dans des salles prévues à cet usage. Comme emprisonné…
Lui voyait tout cela et la tristesse remplissait son âme. Il essaya de perpétuer la tradition orale, se produisant dans des fêtes foraines et des bars. Mais les gens riaient de ses histoires irréelles. Même les enfants perdaient le goût d’entendre des contes. Ils préféraient regarder la télévision, cette boîte à images qui laissait si peu cours à l’imagination, à l’invention. La fantaisie ne s’exprimait plus dans ce monde aseptisé, moderne et froid.
C’est ainsi qu’il avait fini par abandonner. Il s’était laissé aller au désespoir de voir son univers partir à vau-l’eau. Il n’avait plus l’âge de se battre. Seul, le poids était trop lourd. Il avait choisi de vivre dans ses souvenirs. Ce parc, notre parc, était le dernier endroit où il s’était produit. A l’époque le manège tournait encore, les enfants jouaient dans le sable ou sur les allées, et il était un artiste de la rue. Un Rom.
Il s’est tu. Le silence s’est installé. Je ne savais plus quoi dire, quoi faire. Une chape de tristesse m’était tombée sur les épaules. Je sentais trembler les larmes au fond de mes yeux, déformant ma vision, comme un voile vaporeux descendu sur le monde. Il a senti mon trouble. Il m’a dit qu’il ne voulait pas que je sois triste. Pas la nuit de Noël. Nuit de l’espoir entre toutes. Son époque était certes révolue, ajouta-t-il, mais il restait persuadé au plus profond de son âme que les Hommes finiraient par se rendre compte qu’ils ne pouvaient se passer de gens tels que lui. L’art populaire ne se perdrait jamais complètement, car l’imaginaire et le merveilleux étaient nécessaires à la vie même. L’essence de l’existence.
Je l’ai crû. Pourquoi serais-je venue ainsi vers lui, si je n’avais pas moi-même ressenti le besoin de quelque chose que j’étais incapable de nommer ? Une forme de tendresse, de la poésie, pour remplir le vide de ma vie si parfaite.
Le vieil homme était assis, courbé, voûté, sur un banc décrépi du jardin public situé en bas de chez moi, en plein cœur de la ville. Une ville comme toutes les autres, grande, grise et polluée, mais qui recelait des merveilles pour ceux qui savent encore regarder.
Il m’avait appris à ouvrir les yeux.
Quand je l’ai trouvé, ce matin-là, il était déjà tout froid, raidi par la mort. Son sourire semblait m’être adressé, mais son regard était perdu loin au-delà des réalités de notre monde. Parti quelque part au royaume des anges…
Je me suis occupée d’appeler la police et de régler toutes les formalités. Ne sachant pas ce qu’il aurait voulu, je l’ai fait incinérer puis j’ai laissé le vent emmener ses cendres sur ses ailes, à travers ce monde qu’il avait tant parcouru et tant aimé.
Des semaines plus tard, son souvenir continuait à me poursuivre, à me porter. Je le revoyais sur son banc, ce banc où je n’arrivais plus à m’asseoir. Son image était gravée dans ma mémoire. Je ne pouvais – ni ne voulais – oublier son sourire rare mais si chaleureux, ses grands yeux noirs qui s’étaient remplis de petites lumières dansantes lorsqu’il m’avait raconté sa vie, sa joie de transmettre le bonheur aux autres. Et sa voix, avec cet accent indéterminé venu d’un ailleurs lointain.
Une idée folle avait germé dans mon esprit, juste après sa disparition. Une idée qu’il m’avait inspirée et que, pour lui, j’avais envie de réaliser. Il m’avait appris à voir le monde différemment, et je ne pouvais plus fermer les yeux. La banalité de ma vie avait volé en éclats grâce à lui. Je voulais tant le remercier !
Alors j’ai tout quitté, et je me suis lancée. Son art, l’art de surprendre les gens dans leur quotidien terne, l’art de jouer avec les mots et les émotions, l’art de donner vie au fabuleux, à l’incroyable, méritait plus que de survivre dans mon seul cœur. Je me suis mise moi aussi à raconter des histoires, à les écrire. Je me suis aperçue qu’il suffisait pour cela que je laisse s’exprimer mes émotions.
C’est ainsi que j’ai commencé, il y a maintenant des années, à fouiller les mémoires, à extraire de leurs oubliettes des contes et légendes d’un autre âge, à créer mes propres récits.
Il m’a offert la vie, le bonheur. Pour essayer de lui rendre hommage à ma manière, j’ai décidé de raconter aux enfants qui venaient encore – et qui viennent de plus en plus nombreux – jouer dans notre jardin, des histoires. Son histoire. Près de ce banc. Son banc.
Et j’ai voyagé. J’ai rencontré d’autres conteurs. Car aux quatre coins du globe existent des gens plein d’enthousiasme et d’énergie qui se battent eux aussi pour faire vivre cet art intemporel de la parole, art d’un autre temps qui redevient petit à petit populaire.
Je me suis aperçue que le vieil homme avait raison. Les gens ont besoin de merveilleux dans leur vie pour être heureux…
L’envie de partager et le regard presque naïf, mais toujours rêveur, qu’il portait sur le monde et qu’il m’avait donné en héritage ont été les plus beaux cadeaux de Noël que j’ai jamais reçus…
Je ne l’ai pas oublié.
© Julie Turconi
Montréal, le 2 décembre 2002
J’ai toujours eu du mal à me réveiller le matin. Après quelques longs étirements, je me suis levée, je suis allée à la salle de bain, puis à la cuisine. Une sensation étrange me collait à la peau. Un manque, un reproche peut-être. Une réprobation muette. J’ai fait réchauffer le café de la veille et je me suis assise à la table illuminée par le soleil du matin. C’est là que je l’ai remarquée. Elle attendait, assise sur une chaise. Une autre chaise.
Je suis restée longtemps à regarder cette forme sombre, floue mais bien présente. J’étais incapable de réfléchir. Mon cerveau semblait bloqué, ses neurones immobiles, mon sang figé. Puis j’ai formulé la seule pensée qui s’imposait à moi, à voix haute et claire, qui a résonné dans la pièce : une ombre me regarde. J’ai senti un rire monter dans ma gorge, rire qui n’a jamais atteint mes lèvres. Car la silhouette floue ne bougeait pas et semblait vraiment me regarder. J’aurais juré qu’elle avait les bras croisés, exactement comme moi quand je réclame des explications.
Puis j’ai sursauté. Et si quelqu’un était entré chez moi ? Cette ombre, il fallait bien qu’elle appartienne à un être humain, à un corps quelconque… Un frisson m’a parcourue. J’ai saisi un couteau sur la table, arme dérisoire, et j’ai regardé partout autour de moi, en alerte. Sous la table, dans le placard, par la fenêtre… rien. Ou plutôt personne.
Pendant ce temps, l’ombre restait immobile.
Je me suis laissée retomber sur ma chaise, abasourdie. Il fallait que je me rende à l’évidence : si cette ombre appartenait bien à quelqu’un, à quelqu’un qui se trouvait dans la maison, ce ne pouvait être qu’à moi…
J’ai longtemps hésité avant de plonger le regard dans le prolongement de ma propre personne. J’ai cru devenir folle quand je n’ai vu aucune zone sombre autour de moi. Le sol était lumineux, ensoleillé, sans écran opaque, sans obscurcissement. La silhouette sur la chaise a hoché la tête, comme pour confirmer ma découverte : l’ombre devant moi était bien la mienne. Mon double, mon inséparable compagne,
celle qui avait toujours été à mes côtés, quoi qu’il arrive. Que lui était-il donc arrivé ? Que nous arrivait-il donc ?
J’en venais presque à la considérer comme une entité à part entière. Mais une ombre n’est qu’un reflet, une projection. J’ai voulu tendre la main, la toucher, éprouver sa présence: mes doigts ont traversé le fantôme qu’elle était et se sont obscurcis à son « contact ». J’ai retiré ma main, vaincue, convaincue, et je lui ai demandé: pourquoi ? Elle m’a fait un signe. Un signe qui prouvait son existence propre, indépendante… impossible. J’ai fermé les yeux, si fort et si longtemps que des taches de lumière se sont mises à danser derrière mes paupières closes, à exploser dans le noir, s’éteindre, renaître. J’ai senti une douleur envahir mon crâne. J’ai soupiré intérieurement et, espérant n’avoir fait qu’un cauchemar, j’ai rouvert les yeux. Pour trouver l’étrange silhouette floue toujours assise en face de moi, sur sa chaise. Les bras croisés, j’en jurerais.
Je me suis levée. Allait-elle m’accompagner malgré tout, et me montrer qu’elle était encore un peu à moi ? Elle n’a pas bougé. Autour de moi, la lumière crue, intense. J’ai alors ressenti une véritable absence. Pourtant, je n’avais jusqu’alors prêté aucune attention à cette compagne inséparable. La seule qui ne me quitterait jamais. Je le croyais, du moins. Jusqu’à ce matin.
L’ombre s’est redressée sur sa chaise, de toute sa hauteur, dans une attitude accusatrice. Comme si ce qui se passait était de ma faute ! Je me suis alors mise en colère. Je l’ai invectivée et j’aurais voulu la bousculer, la pousser en bas de la chaise. Être dans l’impossibilité de le faire m’a calmée d’un coup sec. Je me suis mise à pleurer. Les nerfs, sans doute. Ou la peur.
Ce matin, mon ombre m’a quittée.
Si mon ombre m’avait quittée, cela signifiait-il que ma fin était proche et qu’elle ne voulait pas mourir avec moi? J’ai levé les yeux sur elle, en essuyant mes larmes. J’ai avancé le menton, dans un geste interrogateur. Si je ne pouvais pas expliquer raisonnablement ce que je voyais, peut-être le pourrait-elle, à sa façon. La crise était finie, j’étais prête à l’écouter.
Elle a hoché la tête, a tendu la main vers moi. Un bras long, démesuré, aux contours imprécis. Elle a pointé un doigt sur moi. Sur mon cœur. Puis elle a reposé la main sur ses genoux et elle a attendu. J’ai compris : elle visait mon cœur qui ne la voyait pas, qui ne se souciait jamais d’elle, mon cœur pris par un autre, une autre. Était-elle jalouse? Non, ce n’était pas aussi simple. Car alors, elle m’aurait quittée dès la première infidélité.
Pourtant, je sentais que j’étais sur la bonne voie, et mon ombre m’encourageait, muette, à suivre le cours de mes pensées. J’avais l’impression qu’elle lisait en moi comme dans un livre ouvert. Mot après mot, ligne après ligne. Et elle me guidait dans ma découverte, patiente. Je ne la voyais plus tant accusatrice que compagne. Je me rendais compte, petit à petit, qu’elle avait besoin de moi tout comme j’avais besoin d’elle. C’était étrange, jamais je n’avais pensé à mon ombre de cette façon-là. Je l’avais toujours tenue pour acquise, appendice obligatoire et discret dont on ne fait aucun cas, car il ne gêne ni ne se manifeste jamais.
Une absence: de lumière, de vie. D’intérêt.
Je commençais à la percevoir comme une entité bien distincte, une prolongation de moi qui n’était pas une simple image diluée, condamnée à me suivre ou à me précéder, selon la direction des rayons de lumière.
Je l’ai alors regardée avec attention: ses contours semblaient plus nets, son obscurité plus profonde. Mon ombre prenait corps, se nourrissait de mes pensées, de mes sentiments nouveaux. C’était donc bien ça : je l’avais délaissée ! Elle me paraissait si naturelle, si négligeable. Mais je comprenais, à présent : en l’oubliant, je la tuais à petit feu. Je la condamnais à n’être plus rien pour personne. Plutôt que de se laisser déposséder du peu qui la maintenait en vie, elle avait décidé de me quitter, de se séparer de moi. Ou peut-être n’avait-elle pas eu le choix, n’avait-elle pu résister à la coupure que j’avais moi-même provoquée. Étais-je en train de me perdre, moi aussi ? D’oublier qui j’étais, mon âme même, au profit d’un vide toujours plus grand ?
Elle m’avertissait, me mettait en garde, et j’avais bien failli ne rien voir, ne rien comprendre. Cette fatigue qui m’envahissait parfois, la mélancolie qui prenait possession de mon cœur, cette sensation fugace de perte, de vide…
Ressaisis-toi !
J’ai souri. J’ai tendu la main vers elle, puis j’ai ouvert les bras. Je l’ai appelée de toute mon âme :
Reviens !
© Julie Turconi,
Montréal, le 20 mars 2006